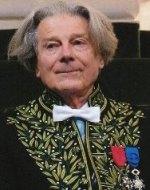Les noms français en rapport avec le pied proviennent dans leur grande majorité du latin pes, pedis, à commencer, justement, par pied, ou du grec pous, podos. On retrouve, dans le premier cas, l’élément de composition péd- ou -pède selon que cet élément est en début de mot, comme dans pédicure ou pédiluve, ou en fin de mot, comme dans lagopède, oiseau encore appelé « perdrix des neiges » et dont les pattes duveteuses ressemblent à des pattes de lièvre, ou dans palmipède. Il en va de même avec la racine grecque pod(e), que l’on retrouve dans podologue ou podomètre, mais aussi dans myriapodes, animaux que l’on connaît mieux sous le nom de millepattes. Mais il existe de nombreux autres mots issus du latin ou du grec, dont le rapport avec le pied est moins évident. Ainsi le nom piège est issu du latin pedica, qui désignait un système de liens et d’entraves dans lequel se prenait celui qui y mettait le pied. Ce nom avait un parent : le verbe pedicare, « prendre au piège », qui se trouve être le lointain ancêtre de notre verbe piger, « saisir, comprendre». De ce verbe dérive impedicare, « entraver, faire tomber dans le piège », d’où est issu le français « empêcher ». Impedicare avait un antonyme expedire, dont le sens premier est « dégager le pied des liens qui l’entravent » ; c’est de lui que viennent, entre autres, les noms expédients et expédition. Autre dérivé du latin pes, pedis, la forme médiévale pedagium ; elle désignait d’abord ce dont il fallait s’acquitter pour être autorisé à mettre le pied en quelque endroit, c’est-à-dire un droit de passage et elle est ainsi à l’origine de notre péage qui, contrairement à ce qu’on croit souvent, n’est pas étymologiquement rattaché à l’idée de paiement. Quant à l’adjectif pédestre, il est lui emprunté de pedester, « qui est à pied », puis « qui appartient à l’infanterie ». Mais comme, dans l’Antiquité, ceux qui avaient les moyens de posséder et d’entretenir un cheval, les cavaliers à Athènes et les chevaliers à Rome, appartenaient à la classe dominante, ceux que leur manque de fortune obligeait à combattre à pied étaient peu considérés : pédestre a donc eu dans la langue populaire un doublet, l’adjectif piètre. Le terme piétaille, issu du latin médiéval peditalia, « infanterie », comporte lui aussi une connotation péjorative. Le mépris de la cavalerie pour l’infanterie apparaît sous une autre forme dans les noms infanterie et fantassin, qui l’un et l’autre viennent de l’italien infante, « petit garçon », puis « jeune soldat ». On notera d’ailleurs avec amusement que l’infanterie, qui est une des composantes principales de « la grande muette », comme on surnomme parfois l’armée, tire son nom, par l’intermédiaire de l’italien infante, du latin infans, dont le sens premier est « qui ne parle pas ».
Dans cette série en lien avec le pied, il faut aussi mentionner l’histoire du mot pedigree ; ce nom d’origine anglaise a le sens de « généalogie » et de « document attestant d’une filiation », mais il a été emprunté, sous les formes pedegrewe, pedigrew ou pedegru, au moyen français pié de grue, désignant la marque faite de trois traits de plume que l’on trouve dans les ouvrages généalogiques pour indiquer une filiation, et qui sont semblables aux traces de pattes de cet oiseau.
Venons-en maintenant à quelques formes d’origine grecque, qui se sont fortement transformées durant leur voyage jusqu’au français. Ainsi podion, « petit pied », est passé en latin sous la forme podium, avec le sens de « soubassement » : le français l’a emprunté ainsi, mais podium a aussi un doublet populaire peu reconnaissable, puy, qui se rencontre essentiellement dans des toponymes. De son côté, le nom franco-normand pieuvre, entré dans la littérature grâce aux Travailleurs de la mer de Victor Hugo, est une altération du latin polypus, « poulpe », forme empruntée du grec polupous, également à l’origine de polype, et qui signifie proprement « qui a plusieurs pieds ». Trapèze nous vient, lui, par l’intermédiaire du latin trapezium, du grec trapezion, diminutif de trapeza, « table » et, proprement, « qui a quatre pieds ».
Concluons en signalant que la racine indo-européenne à l’origine du grec pous et du latin pes a aussi donné le germanique fotu, d’où est tiré l’anglais foot, auquel nous devons le football, et que c’est encore cette racine que l’on retrouve dans les patronymes Agrippa et Œdipe. Le premier signifie en effet proprement « (qui est né) les pieds (pa) en avant (agri) » ; le second, Oidipous en grec, signifie, lui, « aux pieds enflés ». En effet ses parents, de crainte que l’oracle prédisant qu’il tuerait son père et épouserait sa mère ne s’accomplisse, l’avaient abandonné, à peine né, sur le mont Cithéron après lui avoir fait percer les chevilles.
C’est cette mutilation qui aurait provoqué l’enflure de ses pieds.