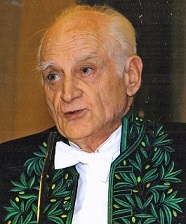Pour évoquer les ennuis qu’on lui fait à Genève, Rousseau écrit au livre XII des Confessions : « […] On [le pouvoir en place] laissait clabauder les caillettes et les cafards […]. » Après avoir admiré l’allitération, penchons-nous sur ces mots qui ont ce son [k] à l’initiale, clabauder, caillettes et cafards.
Clabauder vient du vocabulaire de la vènerie. Il signifie « aboyer fréquemment ; se récrier sans être sur les voies de l’animal chassé » et, figurément, « se répandre en bavardages malveillants ». Dans une épigramme intitulée À messieurs les Académiciens d’au-delà des monts, Saint-Amant l’employait pour brocarder ses confrères :
« Vous feriez mieux de vous taire,
Messieurs les doctes impudents,
Que de clabauder en pédants
Sur des vétilles de grammaire. »
Ce verbe est dérivé de clabaud, chien de chasse aux oreilles pendantes qui aboie sans raison. Ce sens s’est vite étendu aux hommes. On lit ainsi dans la quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française : « On dit figurément & par injure, en parlant d’Un homme stupide & grossier, & qui parle beaucoup & mal-à-propos, que C’est un clabaud. » On y apprend également que, par analogie de forme, clabaud désigne aussi certain couvre-chef : « On dit figurément & familièrement d’Un chapeau qui a les bords pendans, qu’il fait le clabaud, qu’il est clabaud. »
L’origine de clabaud a longtemps été discutée. Littré en faisait une forme tirée de l’ancien haut allemand klaffôn, « bavarder, faire du bruit », mais il évoquait aussi le passage dans la langue commune de Clabault, nom donné à un chien dans le Mistere du vieil testament. Cependant, les autres noms qu’on y trouve : Patault (c’est aussi la première apparition de ce mot en français), Veloux, Satin, laissent à penser que ces noms ont été donnés aux chiens en raison de leur aspect (à grosses pattes pour le premier, au poil doux pour les deux autres).
On a également rapproché ce mot de l’hébreu cheleb ou chalab, ce qui en aurait fait un voisin de notre clebs, emprunté, lui, de l’arabe.
Voyons maintenant les caillettes. Il semble que ce nom soit tiré d’un nom propre, Caillette, qui fut le fou de Louis XII et de François Ier, mais l’influence de caillette, le diminutif de caille, a fortement contribué à son expansion. Ce volatile avait en effet la réputation de criailler continuellement et on supposait que la chaleur de cet animal, signalée par l’expression chaud comme une caille, était liée à une grande ardeur sexuelle. Nicot écrit d’ailleurs dans son Dictionnaire que « L’usage de telle chair engendre le sperme », et Littré signale que l’on appelait familièrement une femme galante « une caille coiffée ». Mais caillette peut aussi qualifier un homme frivole et babillard, appelé franche caillette dans la quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française.
C’est sans doute Voltaire qui assura définitivement le succès de ce nom quand il écrivit, à propos de Mme de Sévigné : « Je l’ai prise une fois [Mme du Deffand] pour madame de Sévigné à son style, mais je n’aurais jamais pris madame de Sévigné pour elle, car, en fait de raison, cette madame de Sévigné est une grande caillette. » On notera avec amusement que l’on trouve comme un écho de ce texte dans la correspondance de Frédéric II de Prusse, qui écrivit au sujet de Mme de Pompadour, qu’il tenait pour responsable des malheurs de la France, qu’elle était « une petite caillette de la rue Saint-Denis ». Rappelons, pour conclure sur nos caillettes et sur l’importance de bien parler, ce mot de l’académicien Duclos dans Les Confessions du comte de*** : « La caillette de qualité ne se distingue de la caillette bourgeoise que par certains mots d’un meilleur usage… »
Venons-en maintenant à nos cafards, nom emprunté de l’arabe kafir, « incroyant », puis « renégat » et enfin « faux dévot, hypocrite », et que les guerres de Religion popularisèrent. Comme ces faux dévots affectaient de fuir la lumière et arboraient des vêtements noirs – pour montrer l’austérité de leurs mœurs –, on donna aussi ce nom aux blattes, insectes sombres et à la vie essentiellement nocturne.
Cafard passa ensuite dans l’argot scolaire pour désigner un délateur. De ce sens on tira le verbe cafarder et sa forme altérée cafter. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’au xixe siècle, les voleurs, qui opéraient plus à l’aise et avec moins de risques quand les nuits étaient bien noires, appelaient la lune la cafarde. À cette même époque, le noir des vêtements des faux dévots et celui des élytres de nos Blattidés fut associé à de sombres pensées, et cafard devint aussi un synonyme de « spleen » ou, pour avoir un nom porteur dans son étymologie de ce noir, de « mélancolie ». Notons, pour conclure, l’élégance bucolique de Rousseau qui, pour désigner ses ennemis, préféra emprunter au registre animalier plutôt que de parler vulgairement de femmes légères et d’hommes empesés.