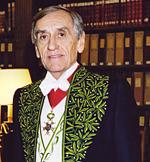Un an après le lancement de
Dire, Ne pas dire il est légitime de s’interroger sur les effets de l’initiative que prit alors notre Académie de doter son site d’un outil permettant une relation plus ouverte, plus spontanée avec ceux des internautes qui se disaient sensibles au bon usage de notre langue et qui semblaient douter de notre réactivité face aux agressions dont elle était victime. À cette interrogation la réponse est claire, ces effets furent heureux. Chacun des cent cinquante articles concernant les emplois fautifs, les extensions de sens abusives, les néologismes, les anglicismes, etc., qui y furent proposés et retenus chaque mois par notre Compagnie fut à l’origine d’une correspondance abondante et riche de suggestions rejoignant les nôtres. Si certains reprochèrent à l’Académie un retard dans l’adoption de mots récents, le plus souvent injustement car il s’agissait de mots déjà admis par la Commission du Dictionnaire, mais non encore publiés ou présents sur la Toile, et si d’autres l’accusèrent d’être trop passive, cette correspondance fut le plus souvent enthousiaste car elle répondait aux soucis de nos lecteurs, auxquels il était démontré que l’Académie ne restait pas indifférente aux entorses infligées couramment à la langue française. En somme un vrai dialogue s’établit entre notre Compagnie et un public passionnément attaché au bien parler.
Une étude statistique de la fréquentation de Dire, Ne pas dire nous confirme qu’à la curiosité que suscita l’annonce par les médias de son lancement a succédé une consultation régulière, attentive de ses pages. Une analyse précise de son audience au cours des dix premiers mois de son existence, du 1er novembre 2011 au 31 août 2012, met en évidence les éléments suivants : 45 395 visiteurs uniques nous ont fréquenté, qui furent responsables de 63 483 visites en consultant 199 387 pages (3,14 pages par visiteur) avec, ce qui est notable, une durée moyenne de visite de 2 minutes 49 secondes et un taux de rebond de 55 %. 72 % d’entre eux nous rendaient visite pour la première fois tandis que 28 % consultèrent plusieurs fois notre site. Il est intéressant de noter que, parmi les rubriques proposées, c’est celle des Emplois fautifs qui fut la plus consultée, suivie à égalité par Extensions de sens, Bonheurs et surprises et Néologismes et anglicismes. Les bloc-notes sont régulièrement lus. C’est donc, en moyenne, 4 500 internautes qui s’informent chaque mois des propositions de notre site Dire, Ne pas dire. Ils sont une fraction des 33 429 internautes qui, entre le 22 octobre et le 21 novembre derniers, ont rendu visite au site de l’Académie française. Une majorité d’entre eux est naturellement d’origine française (23 044) à laquelle s’ajoutent deux à trois mille francophones originaires en parts égales du Canada, de Suisse, de Belgique et d’Algérie. Il en vient aussi des États-Unis, d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne, environ huit cents pour chacun de ces pays. On remarque aussi que la correspondance entretenue avec Dire, Ne pas dire s’est modifiée au cours des mois. Si les internautes signalèrent au départ les fautes les plus grossières du langage parlé et se rassurèrent en voyant que l’Académie les réprouvait également, ils nous ont ensuite demandé si telle ou telle expression, lue ou entendue ici ou là, était correcte et d’en préciser, le cas échéant, les conditions d’emploi. Ils entretiennent avec le Service du Dictionnaire des échanges dont il nous paraît judicieux de publier chaque mois les plus instructifs. Il apparaît nettement que la création de Dire, Ne pas dire a favorisé cette relation avec le Dictionnaire de l’Académie française et le service si compétent de ce dictionnaire.
Peut-on prétendre encore que l’Académie française se cloître entre ses murs et reste indifférente aux mauvais traitements infligés à notre langue ? S’il se peut que certains le croient encore, je les invite à taper sur leur clavier « Académie française » et à choisir, parmi les diverses rubriques qui sont offertes, « Dire, Ne pas dire». Ils y retrouveront sans doute une part de leurs préoccupations concernant notre belle langue.
Yves Pouliquen
de l’Académie française