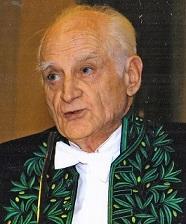Mais est-ce bien prudent ? Non, en français à tout le moins. On oublie trop souvent qu’avant que nos amis anglais nous proposent leur mail, nous en avions déjà un, et qui était beaucoup plus consistant. Le mail français (on se gardera bien d’omettre le i de mail pour ne pas confondre ces trois mots avec le titre d’un célèbre essai d’Alain Peyrefitte) doit son nom au latin malleus et, comme lui, il a d’abord désigné un marteau. Ce terme avait un diminutif, malleolus, dont Cuvier tira au xixe siècle, par analogie de forme, le nom malléole. Pour ce qui est de la prononciation de notre mail, on rappellera que les formes maillet et mailloche en sont dérivées et qu’il rime avec bail ; en ce qui concerne son pluriel, on suivra ce qu’écrivit Thomas Corneille dans une note ajoutée aux Remarques sur la langue française de Vaugelas, dont il fut l’éditeur : « Bal fait bals, & mail fait mails. C’est sans doute pour mettre de la différence entre les pluriels de bail & de mal, qui font baux & maux, car émail fait émaux ». Mais notre mail a vite eu d’autres significations. C’est un peu le parangon des extensions de sens par métonymie. À l’origine, on l’a vu, c’est un marteau. On sait, au moins depuis Charles Martel, que cet outil peut aussi être une arme. On appelait d’ailleurs jadis mail d’armes, ou simplement mail, une arme contondante en forme de marteau, et Montaigne nous apprend que le philosophe Anaxarque d’Abdère, qui était le maître de Pyrrhon, « fut couché en un vaisseau de pierre et assommé (tué) à coups de mail de fer ». Montaigne édulcore un peu le supplice du philosophe qui, s’il faut en croire Diogène Laërce dans ses Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, fut, sur l’ordre du satrape Nicocréon, placé dans un creuset pour y être broyé à l’aide d’un mail, ce qui ne l’empêcha pas de narguer encore son bourreau en lui disant : Ptisse ton Anaxarkhou thulakon, Anaxarkhon de ou ptisseis, « Broie donc le sac qui enveloppe Anaxarque, tu ne broieras pas Anaxarque ! » Au xviie siècle, on trouve au mail un emploi beaucoup plus pacifique ; il sert alors à pousser une balle, que l’on appelle boule de mail, dans un jeu qui tient à la fois du croquet et du golf. Par métonymie le nom mail en vient naturellement à désigner aussi ce jeu. Celui-ci fut fort en vogue à la Cour ; Saint-Simon en témoigne, qui écrit dans ses Mémoires : « Il (Louis XIV) s’amusait (…) à Marly très souvent, à voir jouer au mail, où il avait aussi été fort adroit. » C’est encore par métonymie que le mail va désigner l’espace, le terrain où l’on pratique ce sport.
Enfin, métonymie toujours, mail désigne de nos jours une promenade publique où l’on jouait jadis au mail. C’est essentiellement le sens qu’a conservé ce nom aujourd’hui, sens immortalisé par Anatole France dans le premier volume de son Histoire contemporaine, intitulé précisément L’Orme du mail.
Et ce mail a laissé aussi des traces en Angleterre, puisque c’est de lui qu’est issu le nom mell, qui n'est plus guère en usage et qui désigne un gros marteau. D’autre part, le jeu de mail évoqué plus haut a été populaire dans de nombreux pays d’Europe. Nos amis Italiens le nommaient pallamaglio, nom composé de palla, « balle », et maglio, « marteau, maillet », une forme tirée, elle aussi, du latin malleus. Nous leur empruntâmes ce nom pour en faire le pallemaille. De là, le jeu passa en Angleterre, où il fut appelé pall-mall. Par un système de métonymie semblable à celui que l’on a vu pour le nom mail, pall-mall désigna une large allée où l’on pratiquait ce jeu, et enfin sa forme abrégée mall désigna et désigne encore une avenue importante servant de lieu de promenade.
Quant au mail de nos amis anglais, il offre lui aussi un bel exemple de métonymie. Ce mot, tiré du germanique malha, « coffre », est un cousin étymologique de notre malle. Le nom malle-poste date de 1793, mais moins de dix ans plus tard le français adoptait aussi son équivalent anglais, mail-coach, qu’il employait pour désigner la malle-poste, mais également une berline à quatre chevaux. Ce mail-coach, dans lequel coach est tiré de l’ancien français coche, cher à Montaigne, était parfois abrégé en mail. Et la boucle de ces noms allait être bouclée par Anatole France, qui, trois ans avant d’écrire L’Orme du mail, évoquait ce moyen de transport dans Le Lys rouge : « Elle (Thérèse, le personnage principal), devait faire, à deux heures, une promenade en mail, avec son père, son mari, la princesse Seniavine, madame Berthier d’Eyzelles, la femme du député, et madame Raymond, la femme de l’académicien. »