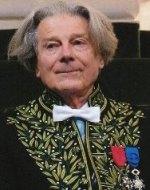Chaque mois, nous nous efforçons dans cette rubrique de corriger les fautes trop souvent entendues ici ou là. Il s’agit non de s’ériger en maîtres censeurs, mais véritablement d’aider ceux qui souhaitent écrire et parler correctement, tant il est vrai que la langue française a parfois des subtilités qui ne sont pas aisées à saisir. Flaubert en présente quelques-unes dans un passage de Bouvard et Pécuchet, dans lequel ses personnages, désireux de se lancer dans l’écriture, apprennent qu’ils doivent se faire la main en imitant les classiques ; cependant il leur apparaît rapidement que même les plus grands auteurs ont péché, non seulement par le style, mais encore par la langue. Déconcertés par cette révélation, ils décident d’apprendre la grammaire, ce qui donne le savoureux passage suivant :
« Avons-nous dans notre idiome des articles définis et indéfinis comme en latin ? Les uns pensent que oui, les autres que non. Ils n’osèrent se décider.
Le sujet s’accorde toujours avec le verbe sauf les occasions où le sujet ne s’accorde pas.
Nulle distinction, autrefois, entre l’adjectif verbal et le participe présent ; mais l’Académie en pose une peu commode à saisir. Ils furent bien aises d’apprendre que leur, pronom, s’emploie pour les personnes, mais aussi pour les choses, tandis que où et en s’emploient pour les choses et quelquefois pour les personnes.
Doit-on dire “Cette femme a l’air bon” ou “l’air bonne” ? “une bûche de bois sec” ou “de bois sèche” ? “ne pas laisser de” ou “que de” ? “une troupe de voleurs survint” ou “survinrent” ?
Autres difficultés : “Autour et à l’entour” dont Racine et Boileau ne voyaient pas la différence ; “imposer” ou “en imposer” synonymes chez Massillon et Voltaire ; “croasser” et “coasser”, confondus par La Fontaine, qui pourtant savait reconnaître un corbeau d’une grenouille.
Les grammairiens, il est vrai, sont en désaccord. Ceux-ci voient une beauté où ceux-là découvrent une faute. Ils admettent des principes dont ils repoussent les conséquences, proclament les conséquences dont ils refusent les principes, s’appuient sur la tradition, rejettent les maîtres, et ont des raffinements bizarres. Ménage, au lieu de lentilles et cassonade, préconise nentilles et castonade. Bouhours jérarchie et non pas hiérarchie, et M. Chapsal les oeils de la soupe.
Pécuchet surtout fut ébahi par Jénin. Comment ? des z’hannetons vaudrait mieux que des hannetons ? des z’haricots que des haricots ? et, sous Louis XIV, on prononçait Roume et Monsieur de Lioune pour Rome et Monsieur de Lionne !
Littré leur porta le coup de grâce en affirmant que jamais il n’y eut d’orthographe positive, et qu’il ne saurait y en avoir.
Ils en conclurent que la syntaxe est une fantaisie et la grammaire une illusion. »
Rappelons cependant que dans la rubrique intitulée Questions courantes, qui se trouve sur son site, l’Académie a répondu à quelques-unes des angoisses de nos deux héros, comme celle qui concerne l’accord du verbe après un singulier collectif suivi d’un complément de nom au pluriel, ou encore l’accord après « avoir l’air », mais on notera avec amusement – ou avec inquiétude – que là où Flaubert écrit Cette femme a l’air bon (ou bonne), l’Académie écrit Elle a l’air malin (ou elle a l’air maligne ?). Étonnante permanence des interrogations suscitées par la langue !